En 1971, des soldats américains ont commencé à tuer leurs propres officiers au Vietnam. NF
En 1971, des soldats américains ont commencé à tuer leurs propres officiers au Vietnam.
22 octobre 1971. 2 h 00. Camp de base Deianne, quartier général de la 1re division d’infanterie. L’air à l’intérieur de la baraque est saturé d’odeurs de toile, de boue séchée et d’huile d’armement. Seuls le ronronnement d’un groupe électrogène diesel à une centaine de mètres et la respiration régulière des hommes endormis parviennent à percer le silence.
Ce ne sont pas des hommes de première ligne. Ce sont des troupes de soutien. Ils sont à l’abri des mortiers du Viet Cong et des embuscades de l’armée nord-vietnamienne. Du moins, c’est ce qu’ils sont censés être. Une ombre se déplace sur le grillage de la porte. Ce n’est pas un sapeur ennemi. C’est un homme en treillis de jungle, de fabrication américaine.
Il ne porte pas de fusil. Dans sa main droite, il tient une grenade à fragmentation M26. La goupille de sécurité est déjà redressée pour faciliter son extraction. Il ne regarde pas les silhouettes endormies dans les couchettes des sous-officiers. Son attention est fixée sur le coin cloisonné de la baraque, le logement semi-privé du sergent-chef.
Le geste est fluide, familier. La goupille est retirée. La cuillère tinte en se détachant de son enveloppe métallique. La mèche à l’intérieur entame sa combustion de quatre secondes. L’homme ne lance pas la grenade. Il la fait rouler. Il la fait rouler doucement sur le plancher en contreplaqué, comme un joueur de bowling cherchant un spare. Elle glisse sous le lit de camp dans le coin.
L’homme se retourne et s’enfonce dans l’obscurité humide. Il ne court pas. Courir attirerait l’attention. Il marche. Quatre secondes plus tard, la baraque explose. L’explosion est assourdissante. Un craquement sec qui déchire les tympans et déchire le silence de la base. La grenade M26 est conçue pour tuer tout ce qui se trouve dans un rayon de 15 mètres grâce à plus de 1 000 fragments de fil d’acier dentelé. Le plancher vole en éclats.
Le lit de camp est réduit en miettes. Le sergent-chef est tué sur le coup, son corps déchiqueté par les munitions mêmes que son armée avait utilisées pour le défendre. La confusion s’installe. Les sirènes hurlent. Les hommes se précipitent sur leurs gilets pare-balles et leurs fusils, s’attendant à une attaque au mortier. Des fusées éclairantes zèbrent le ciel, projetant des ombres mouvantes et sinistres sur le camp. Mais aucun tir ne vient frapper.
Aucun tir ennemi ne provient du périmètre. Seul le cratère fumant à l’intérieur de la baraque et l’odeur de cordite flottent dans l’air. Dans l’ombre, le tueur allume une cigarette et rejoint les rangs, se fondant parfaitement dans la masse. Ce n’était pas un accident. Ce n’était pas un dysfonctionnement. C’était un message. En 1971, l’armée américaine au Vietnam ne combattait pas seulement les communistes. Elle était en guerre contre elle-même.

L’incident de Dion n’était pas un cas isolé, mais bien une statistique. En 1969, l’armée a recensé 96 agressions à l’explosif confirmées contre des officiers et des sous-officiers. En 1970, ce nombre avait grimpé à 209. En 1971, il atteignit un pic de 333, et il ne s’agissait là que des agressions impliquant des explosifs et ayant fait l’objet d’un signalement.
On appelait cela le « fragging ». Ce phénomène devint la pathologie emblématique de la fin de la guerre du Vietnam. Il transforma la chaîne de commandement en une négociation. Il transforma les bases en zones de terreur où les officiers dormaient avec leurs pistolets chargés et où les sous-officiers refusaient de patrouiller dans leurs propres casernes la nuit. Ce fut l’effondrement ultime de la discipline militaire.
La machine se détruisait elle-même. Pour comprendre pourquoi les soldats américains ont commencé à assassiner leurs chefs, il faut prendre du recul par rapport à la situation tendue de Dion et observer la carte du Sud-Vietnam en 1971. La guerre avait changé. Les grandes offensives de 1965 et 1967 appartenaient au passé. Les violents combats de l’offensive Ted en 1968 n’étaient plus qu’un lointain souvenir.
La stratégie désormais adoptée était la vietnamisation. Le président Nixon avait promis de rapatrier les soldats. Les effectifs diminuaient. En 1969, plus d’un demi-million de soldats américains étaient déployés aux États-Unis. Fin 1971, ce nombre était tombé à 156 000. Cela créait un paradoxe, un paradoxe mortel. Les États-Unis se retiraient. Tout le monde le savait. Les hommes politiques le savaient.
Les généraux le savaient. Et le jeune conscrit de 19 ans, sac au dos, dans la vallée d’Asie, le savait aussi. L’objectif n’était plus de gagner. L’objectif était de partir. Mais avant de partir, il fallait continuer à se battre. Il fallait continuer à patrouiller. Il fallait continuer à mourir. C’était là le point de friction, le décalage entre la stratégie de repli et la tactique d’engagement.
Le soldat américain de 1971 était différent de celui de 1965. En 1965, l’armée était en grande partie professionnelle, composée de militaires de carrière et de volontaires animés par la volonté d’enrayer le communisme. En 1971, l’armée était devenue une armée de conscription. Les soldats étaient plus jeunes, plus cyniques et profondément liés à la contre-culture américaine.
Ils arboraient des symboles de paix sur leurs casques. Ils écoutaient du rock aux accents rebelles. Ils lisaient les articles sur les manifestations contre la guerre dans le journal Stars and Stripes. Ils ne voulaient pas être les derniers à mourir pour une erreur. Pour la grande majorité de ces hommes, l’objectif n’était pas la victoire. L’objectif était de pouvoir rentrer chez eux à temps.
C’était le chiffre le plus important de leur vie : 365 jours. C’était la durée de leur service. Chaque jour était une case cochée sur un calendrier. Chaque patrouille représentait un risque pour ce chiffre. La survie était leur seule priorité. Et puis, il y avait le système dans lequel ils étaient pris au piège. Le système de remplacement de l’armée américaine était individuel, et non organisé par unité.
Un soldat ne s’entraînait pas avec une unité, n’était pas déployé avec une unité, et ne rentrait pas avec une unité. Il était envoyé seul. Il arrivait seul. Il était un rouage inséré dans une machine déjà en marche. Il n’avait aucune loyauté envers l’histoire du bataillon ni envers la réputation du régiment. Sa loyauté allait au petit groupe d’hommes de son escouade qui tentaient de le maintenir en vie.
Les officiers, en revanche, vivaient à un rythme différent. Un officier de carrière, un pur produit de son métier, avait besoin d’expérience en commandement pour être promu. Il lui fallait un palmarès de combats. Un nombre de victimes à accumuler. Il devait faire preuve d’agressivité. Il était là pour faire la guerre. Le service militaire, lui, servait à survivre à l’année. Ces deux objectifs étaient diamétralement opposés.
Au début de la guerre, cette tension était gérée par la discipline et une foi partagée dans la cause. En 1971, cette foi avait disparu et la discipline s’effondrait. L’environnement des bases arrière a favorisé cet effondrement. On imagine souvent la guerre du Vietnam comme une guerre de patrouilles dans la jungle et de bases de feu.
Mais en 1971, la majorité des troupes américaines étaient composées de personnel de soutien. Elles vivaient dans d’immenses bases comme Long Bin, Daang et Cam Bay. Loin d’être de simples avant-postes, c’étaient de véritables villes tentaculaires de contreplaqué et de tôle. Elles disposaient de piscines, de cercles pour les sous-officiers, de cinémas et de pistes de bowling. Mais c’étaient aussi des prisons. L’ennui y était insupportable. La chaleur étouffante.
Des milliers de jeunes hommes, sans autre occupation que des travaux subalternes, l’attente de leur affectation et la crainte des attaques de roquettes, se retrouvèrent désintégrés. Dans ce contexte de vide, la structure sociale de l’armée s’effondra. Deux facteurs attisèrent les tensions : les tensions raciales et l’héroïne. Dès 1971, les troubles raciaux qui agitaient les États-Unis gagnèrent le Vietnam. Les soldats noirs, conscrits de Detroit, Chicago et Los Angeles, refusaient désormais d’accepter le racisme institutionnel de l’armée.
Ils ont vu un corps d’officiers blancs envoyer des Noirs à la mort en proportions disproportionnées. Ils ont vu les drapeaux confédérés flotter au-dessus des baraques dans les unités dominées par les Sudistes. Ils ont créé leur propre solidarité, le DAP, le salut du Black Power. Ils ont établi leur propre territoire dans les clubs et les casernes.
L’expression « allée des âmes » devint courante pour désigner le quartier noir d’une base militaire. Les officiers blancs, souvent élevés dans une société ségrégationniste, ne savaient pas comment gérer cette situation. Ils y voyaient de l’insubordination et réprimèrent sévèrement. Ils exigèrent des coupes de cheveux, des saluts militaires et distribuèrent des avertissements pour des infractions mineures. Ils tentèrent d’imposer la discipline stricte de l’armée américaine dans une zone de guerre où les règles n’avaient plus cours. Puis l’héroïne fit son apparition.
En 1970, l’héroïne blanche de haute pureté, provenant du Triangle d’or, a commencé à inonder le Sud-Vietnam. Pure à 95 %, elle se consommait sans aiguille, par inhalation. Bon marché, elle coûtait 2 dollars la fiole, moins cher qu’un paquet de cigarettes. Pour un soldat terrifié par la mort ou rongé par l’ennui, c’était l’échappatoire ultime.
À la mi-1971, le département de la Défense estimait qu’entre 10 et 15 % des soldats américains déployés au Vietnam consommaient de l’héroïne. Dans certaines unités, ce chiffre atteignait même 30 %. La hiérarchie militaire tenta d’enrayer le phénomène. Les officiers ordonnèrent des fouilles, vidèrent les couchettes, mirent en place des tests urinaires et arrêtèrent les trafiquants.
C’est là que les tensions mortelles ont éclaté. Le militaire à perpétuité qui tentait d’imposer la discipline. Le capitaine qui a ordonné une patrouille dans une zone réputée dangereuse alors que la guerre était censée être terminée. Le sergent qui a arrêté un soldat pour avoir fumé de l’opium. Ils sont devenus des menaces. Ils n’étaient plus seulement agaçants.
Elles représentaient un danger pour la survie et l’évasion du soldat. L’arme de prédilection était facilement accessible. La grenade à fragmentation M26 était omniprésente. Petite, elle pesait environ 500 grammes et tenait dans une poche cargo. Elle ne comportait aucun numéro de série permettant de l’attribuer à un soldat en particulier. À l’explosion, elle s’autodétruisait.
Elle ne laissait aucune trace balistique, aucune marque de rayure sur la balle, aucune empreinte digitale, juste un cratère et un cadavre. C’était l’arme du crime parfaite en zone de guerre. Mais le fragging n’était pas qu’un simple acte de tuer. C’était un langage. Une négociation par l’explosif. Souvent, la première grenade n’était pas destinée à tuer. C’était un avertissement. Une épingle plantée sur l’oreiller de l’officier.
Une grenade lacrymogène jetée dans la baraque pendant son sommeil. Une grenade dégoupillée, la poignée scotchée. Laissée sous sa couchette, de sorte qu’en la déplaçant, il entendrait le bruit de sa propre mort qui s’armait. Le message était clair. Reculez. Fichez-nous la paix. Laissez-nous survivre.
Si l’officier n’avait pas compris le message ou s’il s’était montré encore plus inflexible sur la discipline, la prochaine grenade n’aurait pas sa poignée scotchée. Analysons de plus près les mécanismes de cette défaillance. Elle ne s’est pas produite du jour au lendemain. Elle a commencé lentement au sein des unités de combat. Dans le bush, la relation entre un officier et ses hommes est intime et directe.
Un bon officier, un lieutenant avisé qui écoutait ses sergents expérimentés et ne prenait pas de risques inutiles, était respecté. On le protégeait. Mais un tyran, un arriviste, un officier qui envoyait volontairement sa section en mission périlleuse uniquement pour se mettre en valeur en vue d’une promotion… En 1968, un tel officier risquait de voir ses hommes progresser lentement. Il risquait de constater des dysfonctionnements de sa radio.
En 1969, il pouvait entendre une balle siffler à côté de sa tête, même si elle ne venait pas de l’ennemi. En 1971, il ne se réveillait tout simplement plus. Le plus terrifiant, avec cette épidémie de 1971, c’était sa propagation du champ de bataille à l’arrière. Dans la jungle, les tirs de grenaille pouvaient être confondus avec des combats. Il a marché sur une mine. Nous avons essuyé des tirs de mortier.
À l’arrière, derrière les barbelés d’une base sécurisée comme Daang, il n’y avait plus de camouflage. C’était la guerre ouverte. Prenons l’exemple d’une compagnie stationnée près de Chuli. Le capitaine est un remplaçant. Il arrive en treillis amidonné, un manuel de règlement à la main. Il voit des hommes porter des colliers de perles. Il voit des hommes fumer du cannabis à travers le canon d’un fusil.
Il aperçoit une unité qui a conclu une trêve informelle avec les Viet Cong locaux. « Si vous ne nous tirez pas dessus, nous ne vous tirerons pas dessus. » Ce capitaine décide de faire le ménage. Il ordonne des inspections. Il ordonne des patrouilles de recherche et de destruction dans les collines. Il menace de poursuites judiciaires pour possession de drogue. Il fait son travail. Il fait exactement ce que l’armée lui a appris à faire.
Mais les hommes le perçoivent comme une menace mortelle. Il rompt le pacte social de 1971. Il met leurs vies en danger pour une guerre abandonnée. Des murmures commencent à s’élever au mess. Les regards se croisent, le silence s’installe lorsqu’il entre dans une pièce. Les soldats ne se considèrent pas comme des meurtriers. Ils pensent agir en légitime défense.
Leur raisonnement est absurde, mais il est inébranlable à leurs yeux. Si cet homme continue de nous envoyer au combat, nous mourrons. Si nous le tuons, nous survivrons. C’est lui ou nous. Les statistiques du bureau du juge-avocat général révèlent une réalité glaçante quant aux personnes visées. Plus de 80 % des victimes étaient des officiers ou des sous-officiers. La majorité étaient des sous-lieutenants et des sergents-chefs.
Les hommes qui contrôlaient le plus directement le quotidien des troupes. Le moment des attaques était également révélateur. La plupart des assassinats avaient lieu la nuit. L’obscurité était essentielle, mais ces attaques survenaient aussi de manière disproportionnée après la paie et après la fin des patrouilles. C’était un crime d’opportunité, aggravé par l’instabilité liée à l’alcool et aux drogues.
Mais réduire le problème à la seule drogue, c’est ignorer la défaillance systémique. L’armée américaine au Vietnam était conçue pour la guerre d’usure. C’était une gigantesque machine industrielle destinée à anéantir l’ennemi. Elle reposait sur un flux constant de renforts et de pertes. Lorsque cet objectif a été anéanti, lorsque la victoire est devenue impossible, la machine a continué de tourner, mais ses rouages ont commencé à se rebeller.
Le sergent « shake and bake » devint la cible de cette haine. Il s’agissait de sous-officiers produits à la chaîne aux États-Unis grâce à un programme de formation accélérée. Un simple soldat pouvait devenir sergent-chef (E5) en moins de six mois. Il arrivait au Vietnam avec ses galons, mais sans la moindre expérience du combat.
Il était techniquement supérieur aux fantassins, mais moins expérimenté. On lui confia le commandement d’hommes qui marchaient en tête depuis huit mois. Des hommes qui connaissaient le bruit caractéristique du cran de sûreté d’un AK-47 qui s’enclenche dans les bambous. Lorsqu’un sergent, habitué aux manœuvres d’urgence, tenta de donner des ordres contraires à la logique de survie de l’escouade, il ne fut pas seulement ignoré, il fut pris pour cible.
Le terme « fragging » fit sa première apparition dans le New York Times en janvier 1971. Ce fut un choc pour le public américain, habitué aux récits des carnages ennemis. Il n’était pas préparé à entendre parler des massacres perpétrés dans ses propres rangs. Le sénateur Mike Mansfield prit la parole devant le Congrès en avril 1971.
Il lut dans le rapport les détails de la mort d’un jeune officier tué par ses propres hommes. Le choc ne résidait pas seulement dans la mort elle-même, mais aussi dans l’effondrement de l’idéal américain du citoyen-soldat. La fraternité d’armes s’était muée en bande de conspirateurs. Revenons à la réalité, à la nature même de cette peur. Imaginez-vous lieutenant en 1971.
Tu as 23 ans. Tu vis dans une baraque aux murs de sacs de sable. Tu connais les statistiques. Tu sais qu’une prime est mise sur ta tête. Dans certaines unités, les soldats se donnaient de l’argent. Une prime de 500 $, 1 000 $ pour celui qui avait soudoyé la compagnie. Tu cesses de dormir dans la même couchette chaque nuit. Tu changes tes habitudes.
On n’approche pas des latrines après la tombée de la nuit. On traite ses propres hommes avec la même méfiance lasse que l’on témoigne aux villageois des hameaux. On se sent comme un occupant dans son propre camp. Cette paranoïa a paralysé l’armée. Les officiers ont cessé de donner des ordres qu’ils savaient impopulaires. Ils ont négocié. « Si vous partez en patrouille, nous ferons une longue pause au deuxième point de contrôle. »
Nous n’irons pas jusqu’à la crête. C’était le principe de la recherche et de l’évitement. Les unités quittaient la base, marchaient mille mètres dans la jungle, trouvaient un endroit isolé et s’installaient. Elles communiquaient de fausses coordonnées par radio. Elles simulaient des tirs d’artillerie sur des collines désertes pour faire croire à des combats.
Ils attendaient la fin de la journée, puis retournaient à leur base. La hiérarchie était au courant, mais que pouvait-elle faire ? Si elle insistait trop, les grenades finiraient par exploser. En 1971, le système judiciaire militaire était débordé. Enquêter sur un fracking était un véritable cauchemar. La scène de crime était détruite par l’arme elle-même. Tous les témoins étaient complices.
La loi du silence qui régnait parmi les soldats était quasi infranchissable. Je n’ai rien vu. Je dormais. Ça devait être un sapeur. Même lorsque des suspects étaient identifiés, les condamnations étaient difficiles à obtenir. Les preuves étaient circonstancielles et l’armée redoutait la publicité. Un procès médiatisé ne ferait qu’amplifier le problème.
Souvent, la solution consistait simplement à muter les fauteurs de troubles ou à les renvoyer, à les expulser du pays et à refiler le problème à quelqu’un d’autre. Mais le problème ne disparaissait pas. Il s’aggravait. Au cours des premiers mois de 1971, les incidents de fragmentation à Cam Ran Bay atteignirent un tel niveau que le commandant de la base ordonna de mettre sous clé toutes les grenades à fragmentation dans l’armurerie centrale.
Elles ne devaient être distribuées qu’avant une patrouille de combat. Cela n’a pas fonctionné. Les grenades étaient partout. Elles servaient de monnaie d’échange contre de l’héroïne. Elles étaient volées. Elles étaient thésaurisées. Un soldat pouvait acheter une grenade au marché noir de Saïgon pour 5 dollars. L’offre était inépuisable. L’impact psychologique de cette situation est incommensurable. Une armée repose sur la confiance.
Un soldat doit pouvoir compter sur la protection de son camarade. Lorsque cette confiance est trahie, lorsque ce même camarade complote pour vous tuer, l’armée cesse d’être une force militaire. Elle se transforme en une foule armée. Telle était la réalité de 1971. L’illusion de l’ordre était maintenue pour les caméras et les membres du Congrès en visite.
Mais sous la surface, la corruption était généralisée. Il est nécessaire de réexaminer les chiffres pour en saisir l’ampleur. Le Pentagone a admis 333 tirs de fragging en 1971, mais les historiens militaires et les officiers du JAG de l’époque estiment que le nombre réel était probablement cinq à dix fois supérieur. Combien de tirs accidentels étaient en réalité des tirs de fragging ? Combien de morts au combat étaient dues à des balles dans le dos ? Combien de menaces n’ont jamais été signalées parce que l’officier a tout simplement reculé ? Les chiffres officiels ne sont que la partie émergée de l’iceberg.
Ce climat de rébellion latente régnait au sein de la division. Un récit précis, tiré des archives de la Division américaine de 1971, illustre la complexité de cet effondrement moral. Un sergent de section, vétéran de deux guerres, était réputé pour sa discipline de fer. Il interdisait formellement la consommation de drogue.
Il exigeait le port du casque et du gilet pare-balles en permanence. Il essayait de protéger ses hommes. Ses hommes le détestaient. Ils le traitaient de porc endurci. Une nuit, une grenade lacrymogène fut lancée dans sa baraque. Il sortit en toussant, les yeux larmoyants. Il dégaina son pistolet calibre 45 et tira dans l’obscurité. Il ne toucha personne.
Le lendemain matin, il réunit la section. Il ne cria pas. Il ne proféra aucune menace. Il retira ses insignes de grade. Il leur dit : « Vous voulez diriger cette section ? Allez-y. Moi, j’en ai fini. » Il passa le reste de son service assis dans le bunker de commandement à remplir des formulaires. La section partit en patrouille sans lui.
Deux semaines plus tard, trois de ces hommes périrent dans une embuscade, faute de porter leurs gilets pare-balles. Ironie tragique du sort, la discipline à laquelle ces soldats s’étaient rebellés était souvent leur seul rempart contre la mort. Mais dans la tourmente de 1971, entre héroïsme, colère et sentiment de trahison de la part du gouvernement, cette logique s’est perdue.
L’épidémie de fragging reflétait aussi la lutte des classes au sein de la guerre du Vietnam. Le corps des officiers était majoritairement composé de diplômés de l’enseignement supérieur, tandis que les soldats du rang étaient principalement issus de la classe ouvrière. Les conscrits percevaient les officiers comme les agents d’un système qui privilégiait les riches et condamnait les pauvres. Les reports d’incorporation accordés aux étudiants signifiaient que les fils de l’élite étaient aux États-Unis pour protester contre la guerre sur les campus, tandis que les fils des ouvriers combattaient dans les rizières, fusils d’assaut M16 à la main.
Lorsqu’un officier donnait un ordre, il ne s’agissait pas simplement d’un commandement militaire. C’était un ordre émanant de l’establishment, et la grenade était la riposte des opprimés. Il faut également prendre en compte la militarisation de l’environnement. En 1971, les bases arrière étaient de véritables foyers d’activité, mais elles étaient vulnérables.
Des civils vietnamiens travaillaient sur les bases comme domestiques, cuisiniers et ouvriers. Le marché noir prospérait à l’intérieur du périmètre. Drogues, femmes et armes circulaient librement. La frontière entre la guerre et le vice était inexistante. Dans cet écosystème chaotique, le prédateur était difficile à repérer. Un soldat pouvait entrer dans un bar clandestin, acheter une dose d’héroïne à une femme, la fumer, acheter une grenade à un camarade qui travaillait à l’approvisionnement et la glisser sous la couchette d’un lieutenant.
Tout s’est passé en l’espace d’une heure. L’effondrement fut total. Mais pour saisir pleinement l’horreur de 1971, il faut examiner la réaction des institutions. Comment l’armée américaine a-t-elle tenté d’empêcher ses propres hommes de tuer ses dirigeants ? Elle n’avait aucun plan d’action. Elle a essayé la répression. Elle a essayé l’apaisement.
Ils ont tenté d’accélérer le retrait. La triste réalité est que seule la fin de la guerre a mis fin à ce massacre. Tant que les conscrits alimenteraient la machine, celle-ci continuerait d’exploser. Un incident particulier à Pleu illustre l’effroyable ambiguïté de ces événements : un sergent de messaul a été tué dans son sommeil par une explosion.
L’enquête révéla qu’il détournait de l’argent de la caisse de rationnement. A-t-il été exécuté parce qu’il était un tyran ? Ou parce qu’il privait les hommes de nourriture de meilleure qualité ? Ou encore, s’agissait-il d’un trafic de drogue qui a mal tourné ? Les enquêteurs ne l’ont jamais su. L’unité a été rapatriée trois semaines plus tard. Le dossier a été classé. L’affaire a été close.
La guerre a continué. Voici le paysage de 1971. Un paysage où l’ennemi n’est plus seulement dans la jungle, mais aussi dans le lit voisin. Où le bruit d’une goupille de sûreté qu’on retire est plus terrifiant que le tir d’un mortier. Où l’armée de la nation la plus puissante du monde est démantelée de l’intérieur, grenade à fragmentation après grenade à fragmentation.
Le décor est planté. Nous avons le contexte, l’atmosphère et l’arme. Il nous faut maintenant analyser plus en profondeur l’escalade. Nous devons examiner comment ce phénomène est passé d’incidents de vengeance isolés à une culture systémique de la pression, comment la menace de violence est devenue plus puissante que la violence elle-même et comment les chefs militaires, désespérés de maintenir l’illusion du contrôle, ont commencé à négocier avec les mutins.
Ce n’est pas qu’une simple histoire de meurtre. C’est l’histoire de l’effondrement de l’autorité. Et tout commence par la prise de conscience que les règles n’ont plus cours. Le soleil se lève sur la base de Dion. La fumée s’est dissipée. Les secouristes ont emporté le corps du sergent-chef. Les hommes sont en formation. Le capitaine se tient devant eux.
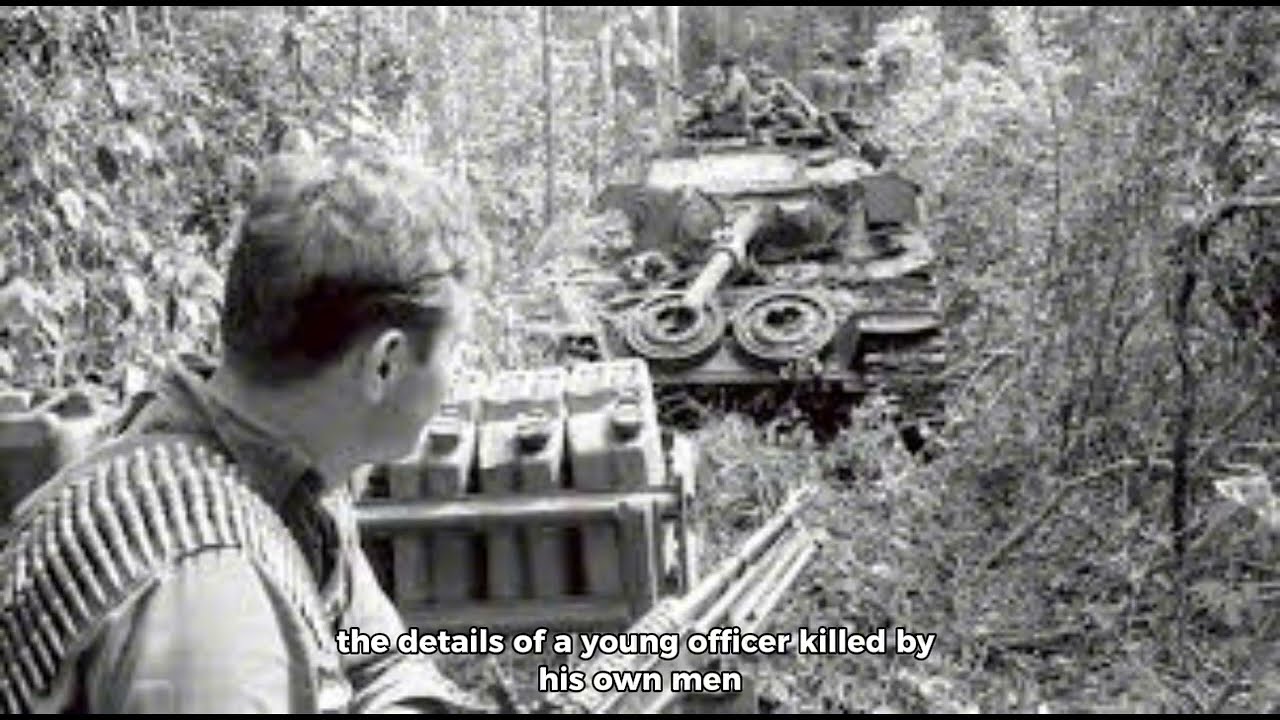
Il les observe. Il cherche un signe de culpabilité, un tressaillement, une expression de satisfaction. Il ne voit rien. Il ne voit que les regards vides et inexpressifs d’hommes qui ont baissé les bras. Des hommes qui attendent l’oiseau de la liberté qui les ramènera chez eux. Un nœud glacial lui serre l’estomac : il est seul.
Il est le commandant d’une compagnie qui a décidé de ne plus être commandée. Et ce soir, le soleil se couchera à nouveau, les ténèbres reviendront et les goupilles seront redressées. La terreur de l’épidémie de fragmentation ne se résumait pas à l’explosion elle-même. Elle se résumait au silence qui la précédait.
Au milieu de l’année 1971, l’armée américaine au Vietnam opérait selon une nouvelle doctrine non écrite. Elle ne figurait pas dans les manuels de campagne. Elle n’était pas enseignée à West Point. Il s’agissait d’une doctrine de négociation. Le commandement avait cessé d’être absolu ; il était devenu conditionnel. Pour comprendre comment cette paralysie s’est installée, il faut examiner le phénomène connu sous le nom de « recherche et esquive ».
Dans les rapports officiels envoyés au Pentagone, les unités menaient des missions de recherche et de destruction. Elles traquaient l’ennemi avec acharnement. Les cartes de Saïgon étaient couvertes de marques au crayon indiquant des patrouilles offensives ratissant les hauts plateaux du centre. Mais sur le terrain, la réalité était absurde. Prenons l’exemple d’une section de la division américaine patrouillant dans la province de Kangai en août 1971.
Le lieutenant est nouveau. Il est impatient. Il désigne une crête sur la carte, une zone connue pour être un foyer d’activité de l’armée nord-vietnamienne. Il ordonne à sa section de se mettre en marche. Le sergent de section, un homme qui est sur le terrain depuis dix mois, regarde le lieutenant. Il regarde la crête. Il regarde ses hommes. Ils nettoient leurs fusils, fument, les yeux rivés au sol. Ils ne bougent pas.
Le sergent prend le lieutenant à part. La conversation se déroule à voix basse, d’une politesse glaçante. Le sergent explique que la section ne se rendra pas sur cette crête. Ils s’enfonceront de 300 mètres dans les hautes herbes. Ils trouveront une clairière ombragée. Ils établiront un périmètre et y resteront six heures.
Si le lieutenant insiste pour la crête, le sergent explique que la section risque de se perdre ou que la radio pourrait tomber en panne. Pire encore, les accidents sont fréquents dans les fourrés denses. Le lieutenant a le choix : il peut faire valoir son autorité, menacer de passer par la cour martiale et imposer sa décision. En 1965, cette méthode aurait fonctionné.
En 1971, c’est une condamnation à mort. Le lieutenant observe les yeux des hommes. Ils sont lourds, vitreux d’épuisement, et leurs pupilles sont particulièrement dilatées par l’héroïne. Ils sont armés de M16, de mitrailleuses M60 et de lance-grenades M79. Le lieutenant acquiesce. La patrouille avance de 300 mètres. Ils s’assoient.
L’opérateur radio signale les points de contrôle non atteints. Point de contrôle alpha sécurisé. Point de contrôle bravo sécurisé. Ils demandent des frappes d’artillerie sur des coordonnées visibles depuis leur position, faisant exploser la jungle déserte pour simuler le bruit de la guerre. C’était la guerre virtuelle. L’armée générait des données, effectuait des patrouilles, tirait des obus, sécurisait des coordonnées… tout cela était entièrement fictif.
Le système exigeait des statistiques, les soldats les fournissaient, mais ils refusaient de verser leur sang. Ce refus généralisé de combattre fut le prélude à la violence. C’est cette mutinerie larvée qui rendit possible la mutinerie brutale du fragging. Lorsque la négociation échoua, lorsqu’un officier refusa de se plier aux ordres, c’est alors que la grenade fut lancée.
L’escalade a suivi un rituel précis, presque bureaucratique tant elle était prévisible. La première étape consistait en l’exclusion sociale. L’officier entrait dans un bunker et toute conversation cessait. Il était exclu du système d’échange de rations et de matériel capturé de l’unité. Il était isolé. La deuxième étape était le sabotage passif.
Ses ordres furent mal compris. Sa Jeep eut un pneu crevé. Son matériel disparut. La troisième étape fut l’avertissement. C’est là que commença la guerre psychologique. Une pierre fut jetée sur le toit en tôle de sa baraque en pleine nuit. Une grenade fumigène, jaune ou violette, explosa sous le plancher, emplissant sa chambre d’une fumée colorée suffocante.
Ce n’était pas mortel, mais ça l’a terrifié. Cela montrait qu’on pouvait l’atteindre. L’avertissement le plus glaçant était la grenade dégoupillée. Un soldat prenait un M26, retirait la goupille, mais enroulait un élastique ou un morceau de ruban adhésif autour du levier de sécurité. Il la laissait sur l’oreiller de l’officier.
À son retour, l’agent le trouverait. Il devrait le ramasser avec précaution, les mains tremblantes, et s’en débarrasser. Le message était clair : la prochaine fois, il n’y aurait pas d’élastique. Si l’agent persistait, s’il restait un bureaucrate endurci, un obsédé de la gloire ou un disciplinaire inflexible, alors la quatrième étape était mise en œuvre : la grenade à fragmentation.
Cette évolution a engendré une économie de marché perverse au sein du peloton : le système des primes. Fin 1971, des rapports de renseignement indiquaient que les soldats mettaient de l’argent en commun pour financer l’assassinat de leurs supérieurs impopulaires. Il ne s’agissait pas d’un simple crime passionnel, mais d’un meurtre commandité. Dans la caserne de la 101e division aéroportée, la rumeur courait qu’une prime de près de 1 000 dollars était offerte pour l’élimination d’un commandant de compagnie particulièrement agressif.
C’était une somme astronomique pour un simple soldat gagnant moins de 200 dollars par mois. Cela transformait le meurtre en une source de revenus. L’existence de cette prime changeait la dynamique de l’unité. Désormais, même si un soldat n’avait pas d’animosité personnelle envers l’officier, il pouvait être tenté par l’argent. Ou encore, il pouvait subir la pression du groupe pour contribuer à la cagnotte.
Tout le monde était impliqué. Si vous aviez mis dix dollars dans la cagnotte, vous étiez complice. Impossible de parler. On était liés par le sang et l’argent. Cette solidarité était renforcée par les tensions raciales qui déchiraient l’armée. La fraternité d’âme entre les soldats noirs et les clans similaires parmi les soldats blancs créaient des chaînes de commandement parallèles qui contournaient la hiérarchie officielle.
Dans Soul Alley, sur la base aérienne de Daang, les troupes noires avaient établi une zone de fait interdite à la police militaire. Elles avaient leur propre hiérarchie. Si un officier blanc harcelait un soldat noir, les représailles ne venaient généralement pas de l’individu, mais du groupe. C’était organisé. Un major blanc de la division américaine a déclaré lors d’un débriefing en 1971 : « Je ne commande pas de compagnie. »
Je commande quatre bandes différentes qui portent le même uniforme. Je dois négocier avec les chefs pour qu’ils nettoient les latrines. L’effondrement a été accéléré par l’abondance d’armes. Il faut souligner l’importance de la logistique dans ce chaos. Les grenades M26 et M67 étaient distribuées en caisses, comme de la monnaie courante.
Elles étaient souvent abandonnées par les troupes en patrouille qui ne voulaient pas s’encombrer de ce poids supplémentaire. Un soldat pouvait parcourir le périmètre d’une base et trouver des grenades à moitié enfouies dans la boue. Il n’y avait aucun contrôle, mais l’arme de prédilection ne se limitait pas aux grenades. La mine Claymore était une variante terrifiante de cette technique de fragmentation.
La mine Claymore M18A1 est une mine antipersonnel directionnelle. Elle projette 700 billes d’acier dans un arc de 60°. Dans plusieurs cas avérés, des soldats s’infiltraient dans le périmètre de défense, retournaient une mine Claymore de façon à ce qu’elle pointe vers le bunker de commandement, puis modifiaient le détonateur. Lors d’une attaque, ou au passage de l’officier, l’explosion était dévastatrice.
Cela ressemblerait à une attaque de sapeurs ennemis. Les Nord-Vietnamiens retournaient souvent les mines Claymore lors des infiltrations. C’était la couverture parfaite. L’ambiguïté était leur bouclier. Chaque enquête sur un incident de tir fracking se heurtait au brouillard de la guerre. C’était un obus de mortier. C’était un piège. C’était un tir ami.
Les enquêteurs de la Division des enquêtes criminelles de Cere étaient débordés. Ces policiers tentaient de résoudre des meurtres dans une zone où tout le monde était armé et où le silence régnait. Ils étaient eux-mêmes souvent menacés. Un agent qui posait trop de questions risquait de se retrouver avec une goupille de grenade sur sa couchette.
L’affaire de la base Pace en octobre 1971 constitue l’élément déclencheur de cet effondrement. C’est là que la mutinerie larvée fit la une des journaux. La base Pace était une base d’appui d’artillerie située près de la frontière cambodgienne. Isolée et vulnérable, elle était encerclée par les troupes régulières nord-vietnamiennes. Les hommes de la compagnie Bravo de la 1re division de cavalerie reçurent l’ordre d’effectuer une patrouille d’embuscade nocturne à l’extérieur du périmètre de sécurité.
Ces hommes approchaient de la fin de leur mission. Ils savaient que les Américains se retiraient. Ils savaient aussi que la base serait probablement abandonnée sous peu. L’ordre de partir dans l’obscurité, face à des forces ennemies supérieures en nombre, pour un bout de terrain sans importance, fit voler en éclats les derniers espoirs de discipline. Six hommes refusèrent. Ils ne se révoltèrent pas. Ils ne crièrent pas.
Ils ont tout simplement refusé. Le capitaine, cherchant désespérément à garder le contrôle, a tenté de les persuader. Il ne les a pas arrêtés immédiatement, sachant qu’il n’avait pas les effectifs nécessaires pour arrêter son propre peloton. Le refus s’est propagé. Bientôt, soixante hommes refusaient de partir. Ils ont signé une pétition. Une pétition en plein cœur d’une zone de guerre. Ils ont écrit une lettre au sénateur Ted Kennedy pour lui expliquer qu’on les envoyait en mission suicide.
Ils remirent la lettre à un journaliste de passage. C’était le cauchemar du Pentagone devenu réalité. Les soldats ne se contentaient pas de refuser de combattre ; ils s’engageaient dans un activisme politique armés. La culture du « fragging » s’était muée en une culture syndicale. Ils se mettaient en grève. La réaction de l’armée fut révélatrice : les soixante hommes ne furent pas traduits en cour martiale.
Ils ne les ont pas alignés pour les fusiller. Ils ont retiré la compagnie du front. Ils l’ont remplacée. Ils ont étouffé l’affaire. Ils étaient terrifiés à l’idée que s’ils forçaient trop, la frappe dégénère en fusillade. Cet incident a prouvé à tous les soldats au Vietnam que la hiérarchie bluffait.
Si vous aviez fait front commun, si vous aviez brandi la menace de violence ou de représailles politiques, l’armée aurait cédé. Mais pour l’officier qui n’a pas eu la lucidité de céder, les conséquences sont restées mortelles. Examinons de plus près les mécanismes précis d’une enquête pour assassinats ciblés afin de comprendre pourquoi justice était impossible. Novembre 1970, une base du delta du Mikong.
Une grenade explose dans le mess des officiers, tuant un commandant et blessant deux lieutenants. L’équipe de déminage arrive sur place. Ils sécurisent les lieux. Ils récupèrent les éclats d’obus. Il s’agit de fil métallique standard de l’armée américaine. Des millions de ces fragments existent au Vietnam. Aucun lien avec l’affaire n’est établi par la police scientifique. Ils interrogent le garde à l’entrée. « Je n’ai rien vu. »
Il faisait nuit. Ils interrogent le barman. J’étais à l’arrière. Ils consultent le registre de l’unité. Deux cents hommes avaient accès à la zone. Ils cherchent un mobile. Le commandant était un homme intransigeant. Il avait prononcé cinquante sanctions disciplinaires (article 15) le mois précédent. Deux cents hommes avaient forcément un mobile. Les enquêteurs tentent de relever les empreintes digitales sur le levier de sécurité trouvé près de la porte.
Mais dans l’humidité du delta, les empreintes digitales disparaissent en quelques minutes, et les artilleurs les plus expérimentés portaient des gants ou utilisaient une chaussette pour manipuler la grenade. Il n’y a aucune preuve matérielle. Aucun témoin. Seulement un cratère et une liste de suspects qui inclut tout le bataillon. L’enquête s’éternise pendant des semaines. Le moral est au plus bas. L’unité est inefficace.
Finalement, l’unité C lève le voile. Le rapport est classé sans suite. Le message aux troupes est clair : on peut s’en tirer. Cette impunité a engendré une nouvelle forme d’arrogance. Dès 1971, des histoires ont commencé à circuler, relatant des soldats se vantant ouvertement d’avoir commis des assassinats volontaires dans des bars de Saïgon. C’est devenu un signe de fierté au sein de la contre-culture des sous-officiers.
Tuer un détenu à perpétuité, c’était porter un coup dur au système. L’argot lui-même a évolué. « Frag » est devenu un verbe, un nom et un adjectif. « Ne me frag pas, mec. » « Ce type est une proie facile. » « Je vais lui frag le cul. » L’expression a imprégné le langage. Elle a normalisé la violence. Elle a transformé l’impensable en une figure de style, puis en une réalité.
Il faut également prendre en compte le rôle des sous-officiers, des sergents. Traditionnellement, ils constituent l’épine dorsale de l’armée. Ils assurent le lien entre les officiers et les hommes et veillent au respect de la discipline. Mais en 1971, le corps des sous-officiers était décimé. Les sergents de carrière expérimentés étaient décédés, retraités ou effectuaient leur troisième ou quatrième période de service, épuisés.
Les nouveaux sergents étaient ces jeunes recrues dont nous parlions plus tôt. Ces jeunes sergents, pleins d’ambition, se trouvaient souvent dans une situation périlleuse. Ils avaient le même âge que les conscrits qu’ils commandaient. S’ils prenaient le parti des officiers, ils étaient des cibles. S’ils prenaient le parti des hommes, ils étaient considérés comme des mutins. Nombre d’entre eux ont choisi la facilité. Ils sont devenus complices.
Ils ont fermé les yeux quand la fumée de cannabis s’échappait des bunkers. Ils ont égaré les dossiers disciplinaires et, dans certains cas, ils ont même fourni les grenades. Lorsque le système immunitaire des sous-officiers, véritable rempart de l’armée, a cessé de lutter contre l’infection, celle-ci a fini par les consumer. Une statistique, dans les archives médicales de l’époque, est particulièrement frappante.
En 1971, pour la première fois depuis le début de la guerre, le nombre de soldats évacués pour toxicomanie dépassa celui des soldats évacués pour blessures de guerre. Imaginez un peu : l’armée américaine perdait plus d’hommes à cause de l’héroïne que du Viet Cong. Et l’épidémie d’héroïne était inextricablement liée à l’épidémie de violence armée. Le trafic de drogue exigeait un environnement sécurisé. Il exigeait des officiers qui ne posaient pas de questions.
Il fallait un périmètre où les trafiquants pouvaient circuler librement. Un officier qui tentait d’endiguer le trafic de drogue menaçait un empire de plusieurs millions de dollars géré par les soldats eux-mêmes. À Long Bin, immense base logistique, les réseaux de drogue étaient de véritables organisations. Ils disposaient de coursiers, d’hommes de main et de banquiers. Lorsque le nouveau prévôt-maréchal, chef de la police militaire, arriva et tenta de réprimer le trafic de drogue, il ne se contentait pas d’appliquer la réglementation.
Il s’en prenait au crime organisé. Sa Jeep a explosé. Ce n’était pas un avertissement, mais une décision stratégique. La frontière entre les manifestations contre la guerre et la violence des gangs était devenue totalement floue. Les Américains qui regardaient les informations du soir voyaient des images de hippies et de manifestants à Washington. Ils ne voyaient pas l’anarchie armée qui régnait dans les casernes.
Les attachés de presse militaires travaillaient sans relâche pour étouffer ces informations. Ils usaient d’euphémismes : explosion accidentelle, assaillant inconnu, brèche dans le périmètre du camp. Mais les soldats qui écrivaient à leurs familles disaient la vérité. Les lettres de 1971 regorgent de mises en garde aux jeunes recrues : « Ne vous engagez pas. C’est un véritable enfer. On s’entretue. » La situation était si critique que, dans certaines unités, il fut conseillé aux officiers de porter leur gilet pare-balles à l’intérieur du périmètre de sécurité.
Un capitaine de la 25e division d’infanterie écrivait dans son journal : « Je suis plus en sécurité en patrouille de combat que dans mes propres toilettes. Dehors, l’ennemi vous tire dessus de face. Ici, il vous tire dessus par derrière. » Cette inversion de la sécurité, où la base est la zone dangereuse et la jungle le refuge, a profondément marqué le corps des officiers.
Cela a provoqué un exode massif des talents. Les jeunes officiers, les plus brillants et les plus prometteurs, ont démissionné dès leur retour. Ils ne voulaient rien avoir à faire avec une armée devenue une véritable horde. Ce phénomène a engendré une fuite des cerveaux qui allait peser lourdement sur l’armée américaine pendant une décennie. Mais revenons-en aux causes.
Il est trop facile de se contenter de parler de drogue ou de démotivation. Le problème fondamental résidait dans une rupture de contrat social. Le conscrit avait été enrôlé de force par son gouvernement pour combattre dans une guerre que ce dernier avait déjà admis ne pas chercher à gagner. Le contrat social stipule que l’on risque sa vie pour la nation et que la nation honore ce sacrifice.
Quand la nation annonce son départ mais que vous devez rester et mourir pendant six mois de plus pour sauver la face, le contrat est caduc. Le soldat de 1971 comprit qu’il n’était qu’une munition usagée, un déchet bon à jeter au sol. Il décida alors de devenir un acteur du jeu plutôt qu’un simple pion.
Il décida que s’il devait être un instrument de violence, il choisirait sa cible. Et souvent, cette cible était l’homme qui se tenait devant lui, une carte et une radio à la main, lui ordonnant de foncer droit dans un nid de mitrailleuses. À l’approche de la fin de l’année 1971, la violence se retourna contre lui-même avec une férocité inexplicable. Il ne s’agissait plus seulement de survivre.
Il s’agissait de rage. Une rage nihiliste, alimentée par la drogue, dirigée contre l’uniforme lui-même. Le point culminant de cette folie approchait. Les systèmes de contrôle avaient échoué. Les tribunaux étaient bafoués. Les prisons étaient surpeuplées. Les officiers se cachaient. Et les grenades continuaient de pleuvoir. La désintégration de l’armée américaine au Vietnam ne s’arrêtait pas aux abords des bases de tir.
Le problème s’est infiltré jusque dans les institutions mêmes censées maintenir l’ordre : les prisons et les tribunaux. Fin 1971, le système de justice militaire était complètement paralysé. Le nombre considérable d’infractions – possession de drogue, insubordination, agressions et meurtres – engorgeait les tribunaux. On manquait d’avocats, de juges et, surtout, de cellules.
L’épicentre de cet effondrement était la prison de Long Bin. Les troupes l’appelaient LBJ. Elle était censée être un centre de réinsertion pour les soldats réformés. En 1971, c’était devenu une zone de combat. À l’intérieur de l’enceinte, les gardiens avaient perdu le contrôle. Les détenus étaient organisés par race et par crime.
Des groupes radicalisés contrôlaient les cellules. Durant l’été 1968, une émeute avait éclaté à la prison LBJ : des détenus avaient incendié des bâtiments et occupé l’enceinte pendant des semaines. Dès 1971, l’esprit de cette émeute était devenu la norme. Les gardiens envoyés pour gérer la prison vivaient dans la crainte pour leur vie. L’établissement, conçu pour punir la mutinerie, était devenu le quartier général de cette dernière.
C’est là que le cercle vicieux a pris une tournure mortelle. Un soldat qui avait tué un officier et avait été arrêté – un fait rare – fut envoyé à LBJ. Là-bas, il ne trouva pas de réhabilitation, mais une véritable école de la désillusion. Il y rencontra d’autres auteurs de ces actes, des trafiquants d’héroïne et des militants politiques radicaux. Il comprit qu’il n’était pas un criminel, mais un prisonnier apolitique.
Lorsque ces hommes étaient libérés ou qu’ils communiquaient avec l’extérieur, ils propageaient au sein de leurs unités une haine viscérale et exacerbée envers la hiérarchie. Le système carcéral, loin d’endiguer la propagation, l’alimentait. Parallèlement, la polarisation raciale en leur sein atteignait un point de rupture. Cet élément est essentiel pour comprendre les violences de 1971.
L’épidémie de violence armée liée au fragging est indissociable de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Les soldats noirs, recrutés dans les quartiers défavorisés ravagés par les incendies des années 1960 aux États-Unis, sont arrivés au Vietnam avec une conscience accrue des injustices systémiques. Ils se battaient pour un pays qui les traitait comme des citoyens de seconde zone.
Lorsque des officiers blancs proféraient des insultes racistes, leur interdisaient de porter des coupes afro ou censuraient la littérature pro-Black Power, la réaction fut explosive. Les données du Département de la Défense de 1971 font état d’une forte augmentation des tensions entre les deux camps. C’était le terme euphémistique pour désigner les émeutes raciales. À Camp Baxter, près de la zone démilitarisée (DMZ), une bagarre entre soldats noirs et blancs dégénéra en fusillade.
Des fusées éclairantes ont été lancées. Des M16 ont fait feu. La police militaire a dû prendre d’assaut ses propres casernes avec des véhicules blindés de transport de troupes. Dans ce contexte, le fragging est devenu une arme de guerre. Un officier blanc qui sanctionnait un soldat noir pouvait être pris pour cible non seulement en tant qu’officier, mais aussi comme un symbole de l’oppression blanche. Inversement, les sous-officiers noirs étaient parfois pris pour cible par des subordonnés blancs qui refusaient de recevoir des ordres d’un Noir.
La machine militaire, autrefois si cohérente, s’était fragmentée en factions rivales, et ce chaos était orchestré par une structure de commandement qui refusait obstinément de voir la réalité en face. Pendant des années, les généraux à Saigon, dans le Morland occidental, puis sous Abrams, avaient entretenu un optimisme béat auprès des politiciens de Washington : « On entrevoit la lumière au bout du tunnel. L’ennemi est en train de s’affaiblir. »
La vietnamisation porte ses fruits. Mais en juin 1971, le déni vola en éclats. Non pas à cause d’une bombe, mais à cause d’un article. Le colonel Robert Dhel Jr., historien militaire respecté, publia un article dans l’Armed Forces Journal. Son titre était sans équivoque : « L’effondrement des forces armées ». Il demeure l’une des critiques les plus accablantes jamais écrites contre une armée par ses propres membres.
Hinel ne mâchait pas ses mots. Il écrivait : « Le moral, la discipline et la capacité de combat des forces armées américaines sont, à quelques exceptions notables près, plus faibles et pires qu’à aucun autre moment de ce siècle, voire de toute l’histoire des États-Unis. » Il poursuivait : « Selon tous les indicateurs imaginables, notre armée qui demeure au Vietnam est au bord de l’effondrement : certaines unités évitent ou refusent le combat, assassinent leurs officiers et sous-officiers, sont ravagées par la drogue et démoralisées, voire proches de la mutinerie. C’était le point culminant, le… »
Pendant des années, le public a cru que le problème venait du Viet Cong. Hel a révélé que le problème venait de l’armée américaine elle-même. Le système était défaillant. L’article a eu l’effet d’une onde de choc au Pentagone. Il a forcé les hauts gradés à examiner les données sans le filtre de la propagande. Et les données étaient terrifiantes : les taux de désertion explosaient.
En 1971, 73 soldats sur 1 000 désertaient. Cela équivalait à perdre chaque année une division d’infanterie entière, rien qu’à cause des désertions. À Awall, les taux étaient encore plus élevés. La consommation de drogue, l’épidémie et les frackings étaient les principaux indicateurs d’un effondrement total du commandement. Les généraux prirent conscience d’une vérité terrifiante.
S’ils avaient maintenu l’armée au Vietnam beaucoup plus longtemps, ils n’auraient pas seulement perdu la guerre, ils auraient perdu l’armée elle-même. Les conséquences stratégiques étaient considérables. Les États-Unis s’étaient engagés à défendre l’Allemagne de l’Ouest contre l’Union soviétique. Ils avaient des engagements en Corée du Sud, mais l’armée censée les honorer était enlisée dans les rizières d’Asie du Sud-Est.
Le corps des sous-officiers était décimé. Le corps des jeunes officiers était terrorisé. Le matériel était volé ou détruit par les troupes. Le phénomène des tirs de grenades par fragmentation était passé d’un problème tactique à une crise stratégique. La crainte qu’un simple soldat glisse une grenade sous sa couchette avait remonté toute la chaîne de commandement jusqu’au Bureau ovale.
Le président Nixon et ses conseillers comprirent qu’ils devaient accélérer le retrait, non seulement pour apaiser les manifestants anti-guerre dans les rues de Washington, mais aussi pour sauver l’institution militaire de l’autodestruction. Les soldats avaient, en réalité, voté. Ils avaient voté avec des grenades M26. Ils avaient voté avec des seringues. Ils avaient voté par refus.
Leur vote fut : « C’est terminé. » Cela bouleverse le récit de la fin de la guerre du Vietnam. On entend souvent dire que les États-Unis se sont retirés pour des raisons politiques ou sous la pression de l’opinion publique. La dure réalité est que les États-Unis se sont retirés parce que l’armée était paralysée. Il s’agissait d’une grève générale déclenchée par des attentats à la bombe.
Le tournant décisif survint lorsque les officiers cessèrent de chercher à vaincre et commencèrent à se concentrer sur la survie de leurs hommes. Fin 1971, les tactiques de recherche et d’évitement évoquées précédemment étaient devenues la politique officieuse dans de nombreux secteurs. Les commandants de brigade, conscients de la volatilité de leurs troupes, cessèrent d’ordonner des opérations offensives. Ils créèrent des zones de sécurité où les troupes pouvaient se contenter d’attendre.
La guerre devint une mascarade. Les Américains feignaient de se battre. Les Nord-Vietnamiens, pressentant l’effondrement, les laissaient souvent tranquilles, préférant attendre le départ des Américains plutôt que de verser leur sang dans un combat contre une armée déjà vouée à l’échec. Mais le tragique de ce dénouement réside dans le fait que la violence ne cessa pas avec le simple changement de stratégie.
À mesure que le retrait s’accélérait, le chaos s’intensifiait. C’est le paradoxe de la fin de partie. Lorsqu’une unité se retire, la discipline s’effondre souvent complètement. Il faut restituer le matériel, faire l’inventaire. Dans la confusion qui règne lors du démantèlement d’une base, les risques de vols et de règlements de comptes explosent.
Certains des assassinats les plus brutaux se sont produits dans les derniers jours d’un déploiement. Un sergent qui avait malmené ses hommes pendant un an, se croyant à l’abri car ils allaient rentrer chez eux, allait découvrir que ses hommes avaient la mémoire longue. Ils ne l’ont pas laissé monter dans l’avion. On connaît le cas d’un premier sergent tué trois jours avant son départ.
Il se dirigeait vers les toilettes, une mine Claymore fixée à la porte explosa. Il rentrait chez lui, auprès de sa femme et de ses enfants. Ses hommes s’assurèrent qu’il rentre dans une boîte de transfert en aluminium. Pourquoi ? Parce qu’il avait refusé un laissez-passer ? Parce qu’il avait confisqué une réserve de haschisch ? Ou tout simplement parce qu’il représentait l’autorité haïe qui leur avait volé une année de leur vie ? Le nihilisme était absolu.
Cette période a également vu l’essor du refus de combattre comme action collective. On a parlé de la marche dictée par le feu, mais il y en avait d’autres. En octobre 1971, la compagnie Alpha de la 196e brigade d’infanterie légère a refusé un ordre de patrouille. Ils se sont simplement assis. L’incident a été filmé par une équipe de CBS News. Le monde a vu des soldats américains dire à leurs officiers : « Non », l’image était désastreuse.
Mais la réalité sur le terrain était pire. Les officiers savaient que s’ils forçaient le trait, ils seraient décimés. Alors ils négocièrent. « D’accord, reculez de 500 mètres. Restez à portée radio. » La fière et agressive armée américaine de 1944 ou 1950 avait disparu. À sa place, une force de négociation tentait de se sortir d’une situation inextricable.
Il faut également examiner l’aspect technologique de cet effondrement. L’armée américaine est une organisation technocratique. Elle repose sur des systèmes, une logistique et un appui aérien. Les tirs d’artillerie lors des évacuations médicales ont rompu le lien humain dans cette chaîne technologique. Un observateur avancé assure la liaison entre l’infanterie et l’artillerie. Si l’infanterie se méfie de l’observateur avancé, si elle le soupçonne d’être un militaire chevronné susceptible de demander des tirs d’artillerie trop près de sa position, elle pourrait le cibler.
Sans observateur avancé, l’artillerie est inutile. Sans opérateur radio, l’appui aérien est inutile. La technologie de pointe de la machine de guerre américaine, qui coûte des milliards de dollars, a été rendue impuissante par un différend de deux dollars entre un simple soldat et un sergent. L’épidémie de fragging a révélé l’ultime vulnérabilité de la guerre moderne.
Vous pouvez avoir les meilleurs avions, les meilleurs fusils et les plus grandes quantités de matériel. Mais si le système, l’esprit humain et la confiance sont corrompus, le matériel n’est plus que de la ferraille. Et en 1971, le système était corrompu de manière irrémédiable. Les rapports d’enquête de cette période révèlent une tentative désespérée de trouver un bouc émissaire. L’armée a accusé des agitateurs.
Ils ont accusé les militants du Black Power. Ils ont accusé les toxicomanes. Ils ont tenté d’externaliser le problème. Ils refusaient d’admettre la vérité structurelle. La guerre elle-même était le pathogène. La mission consistant à mener une guerre d’usure sur une terre où l’ennemi était partout et nulle part, pour une cause abandonnée par la patrie, a engendré la folie.
Le fragging était la réponse rationnelle à une situation irrationnelle. Si un homme vous braque avec une arme, vous tirez. En 1971, les soldats avaient le sentiment que l’officier qui pointait la carte était celui qui pointait l’arme. Alors que nous nous orientons vers la résolution de cette affaire, nous devons reconnaître le sombre héritage qu’elle a laissé. Les officiers qui ont survécu à 1971 sont rentrés chez eux transformés. Ils avaient entrevu l’abîme.
Ils avaient perçu leurs propres hommes comme des ennemis. Ce traumatisme allait façonner l’armée américaine pour les trente années suivantes. L’obsession du volontariat, l’obsession de la cohésion des unités, l’obsession de la protection des forces, tout cela est né dans l’ombre de la fragmentation de 1971. Mais avant la réforme, il y eut la ruine.
L’année 1971 s’acheva sur un constat alarmant : 333 frackings confirmés. Mais le nombre réel, qui inclut les menaces, les incidents évités de justesse, les accidents et les actes d’intimidation, se chiffrait en milliers. L’armée américaine ne fut pas vaincue sur le champ de bataille en 1971 ; elle fut en réalité anéantie par ses propres effectifs. La solution définitive à cette épidémie de fracking ne vint pas du juge-avocat général.
Cela ne venait pas de la police militaire. Cela venait de la mort de l’institution elle-même. En 1972, le retrait était presque terminé. Les troupes de combat quittaient les lieux. Les bases étaient remises aux Sud-Vietnamiens ou réduites à leurs seuls éléments. L’armée américaine battait en retraite, mais elle ramenait une contagion aux États-Unis.
Les soldats qui embarquèrent à bord des avions de la liberté à la base aérienne de Tanson ne laissaient pas la guerre derrière eux. Ils ramenaient chez eux la colère, la dépendance et la méfiance envers l’autorité. Et les officiers qui rentrèrent dans le calme des cabines des avions de ligne portaient une cicatrice d’une autre nature : la conscience d’avoir perdu le contrôle.
L’héritage de 1971 fut immédiat et radical. Le Pentagone, face à l’effondrement de sa discipline, fit un calcul historique. Il comprit que la conscription, ce mécanisme même qui avait fourni les effectifs nécessaires aux guerres mondiales, constituait désormais la plus grande menace pour la sécurité nationale. La conscription reposait sur l’obéissance.
Elle reposait sur une population qui reconnaissait la légitimité de l’autorité de l’État. Au Vietnam, cette légitimité s’était évaporée. Les conscrits de 1971 n’étaient pas des soldats, mais des otages. Et les otages finissent toujours par se rebeller. C’est pourquoi les États-Unis ont aboli la conscription. En 1973, le droit de conscription a expiré. Les États-Unis sont alors passés à une armée entièrement composée de volontaires.
Il ne s’agissait pas simplement d’une manœuvre politique pour étouffer les manifestations étudiantes. C’était une stratégie de survie pour le commandement militaire. Il fallait purger les rangs des récalcitrants. Il fallait des soldats motivés, car ceux qui le sont ne cachent pas de grenades sous le lit de leurs sergents. La crise du fragging a été le catalyseur de l’armée professionnelle moderne.
La force disciplinée, technologiquement avancée et soudée que le monde a vue lors de l’opération Tempête du désert en 1991 a été bâtie sur les cendres de l’effondrement disciplinaire de 1971. L’armée a juré que cela ne se reproduirait plus jamais. Mais cette réforme est arrivée trop tard pour les hommes de la génération du Vietnam. Pour les officiers qui ont servi durant ces dernières années particulièrement difficiles, le traumatisme psychologique a été profond.
Ils revinrent dans un pays qui les avait méprisés pour avoir combattu et quittèrent une guerre où leurs propres hommes avaient tenté de les tuer pour avoir dirigé les troupes. Ils étaient pris en étau entre deux haines. Nombre d’entre eux quittèrent l’armée sur-le-champ. Le taux de rétention des jeunes officiers chuta à des niveaux historiquement bas. Les capitaines et les commandants qui restèrent, ceux qui reconstruisirent l’armée à la fin des années 1970, furent endurcis par le traumatisme.
Ils développèrent un style de commandement obsédé par la cohésion de l’unité et la protection des forces. Ils savaient parfaitement ce qui se passait lorsque ce lien se rompait. Les fantômes des incidents de « fragging » hantèrent les casernes pendant des décennies. Le terme « fragging » entra dans le langage courant américain. Il évolua. Il en vint à désigner tout acte de sape envers un supérieur.
Le phénomène s’est déplacé des bas-fonds aux bureaux. Mais son origine est restée la même : le rejet explosif de l’autorité. Examinons une dernière fois les chiffres. Entre 1969 et 1972, on a recensé près de 900 incidents de fragging confirmés. Près de 100 officiers et sous-officiers ont été tués. Plus de 700 ont été blessés. Mais la statistique la plus importante n’est pas le nombre de morts. C’est le chiffre zéro.
Zéro. C’est le nombre de guerres que les États-Unis ont menées avec une armée de conscription depuis le Vietnam. Le spectre des casernes de 1971, la fumée, l’héroïne, les tensions raciales, les négociations silencieuses entre le chef et ses hommes, ont changé à jamais l’ADN de l’armée américaine. Cela a prouvé qu’on ne peut contraindre un homme à combattre dans une guerre à laquelle il ne croit pas. On peut le forcer à porter l’uniforme.
Vous pouvez lui donner un fusil, mais vous ne pouvez pas faire de lui un soldat. Et si vous le poussez trop loin, il deviendra un insurgé au sein même de votre base. La guerre prit fin pour les États-Unis le 27 janvier 1973 avec la signature des accords de paix de Paris. Mais pour les familles des officiers tués par des tirs amis, la paix ne fut jamais revenue.
Les enquêtes ont été classées. Les dossiers ont été archivés. Les décès étaient souvent qualifiés de manière vague afin d’épargner aux familles la vérité brutale. Une mère de l’Ohio a appris que son fils était mort dans un accident dû à une explosion. On ne lui a pas dit que l’engin explosif avait été lancé par son propre chef d’escouade. Ce silence a constitué la dernière couche de la tragédie.
L’armée a enterré ses morts, et la vérité avec eux. Janvier 1973. Le camp de base de Deian est désert. Le vent souffle à travers la moustiquaire déchirée de la baraque où le sergent-chef a péri. Le cratère creusé dans le plancher est rempli de poussière. Les voix des hommes, la colère, la peur, les rires ont disparu. Le silence règne sur la base.
La jungle reprend ses droits. L’expérience américaine au Vietnam est terminée. Mais si l’on tend l’oreille, sous le bruit des hélicoptères et le grondement de l’artillerie, on perçoit l’histoire qui a marqué la fin de la guerre. Ce n’est pas une détonation. C’est le petit cliquetis métallique d’une cuillère de sécurité qui s’échappe de la poignée d’une grenade.
C’est le bruit d’une armée déchirée par la guerre. Un bruit qui résonna longtemps après le décollage du dernier hélicoptère sur le toit de l’ambassade. Il donna à une superpuissance une leçon qu’elle n’oublierait jamais : l’ennemi le plus dangereux n’est pas celui qui se trouve de l’autre côté du fleuve. C’est celui qui dort dans la couchette voisine lorsque la confiance est rompue.
Note : Certains contenus ont été créés à l’aide de l’IA (IA et ChatGPT) puis retravaillés par l’auteur afin de mieux refléter le contexte et les illustrations historiques. Je vous souhaite un passionnant voyage de découverte !




